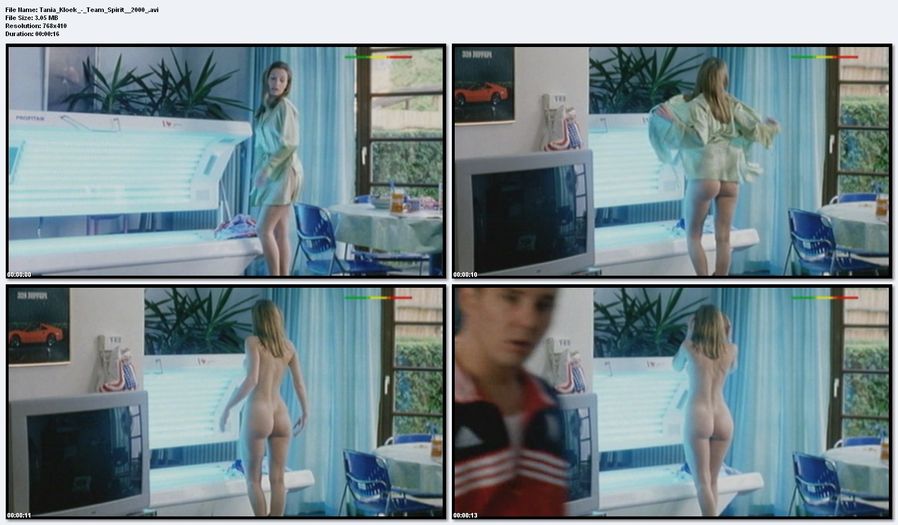"RAW DEAL"
Raw Deal (« Marché de brutes »), Anthony Mann, 1948 ; scénario de Leopold Atlas et John C. Higgins ; photo de John Alton ; avec Dennis O’Keefe (Joseph Sullivan, dit Joe), Claire Trevor (Pattie, dite Pat), Marsha Hunt (Ann), Raymond Burr (Rick), John Ireland (Fantail)

Une nouvelle occasion nous a été donnée par la programmation du câble de se rappeler qu’Anthony Mann n’est pas seulement l’auteur de quelques-uns des plus beaux westerns des années 1950. Mann est en effet loin de ne s’être illustré que dans le genre auquel il doit principalement sa notoriété. Sa carrière, relativement brève par rapport à d’autres classiques américains, mais plutôt féconde (35 films entre 1942 et 1961, puis trois jusqu’en 1968), comporte grosso modo quatre périodes correspondant à quatre genres bien distincts de la production hollywoodienne. Quelques chevauchements d’une période à une autre, et quelques parenthèses – telle la bio-americana « The Gleen Miller Story » (1954), également diffusée il y a peu sur le câble – peuvent évidemment être repérés, mais, schématiquement, voici comment la carrière de Mann se compose.
Une première période est consacrée à des comédies, assez légères dans l’inspiration et dans le ton, mais plutôt lourdingues dans l’exécution. L’année 1945 par exemple (avec les faiblards « Two O’Clock Courage » et « Sing Your Way Home », diffusés l’été dernier), prouve que Mann mit quelque temps à trouver ses marques.
Changement de registre radical peu après, avec notamment « Desperate » (1947), que Mann, d’après le Coursodon / Tavernier, considérait comme son véritable départ. Il est passé à de petits films noirs de bonne facture, dont les intrigues s’apparentent à celle du célèbre « Detour » d’Edgar Ulmer, puisque plusieurs de ses films racontent l’histoire d’un pauvre ère pourchassé, soit par la police, soit par des truands, et même par les deux à la fois la plupart du temps, mais bien plus sûrement encore par le mauvais sort, la poisse semblant le poursuivre de bout en bout. John Dahl est l’un des meilleurs représentants actuels de ce type de film noir (voir « Une Virée en enfer », récemment diffusé), sauf que ce qui nous est raconté aujourd’hui en 1h45 l’était dans les années 1940-1950 en 1h15 ! Le film le plus caractéristique dans cette optique est « Side Street » (1950), que l’absence de temps morts, de "graisse" serait-on tenté d’écrire, sans pour autant que soient négligées quelques pauses, rend assez palpitant. Deux remarques à propos de ce film. Premièrement, Mann réussit l’exploit de rendre Farley Granger supportable. Deuxièmement, il comporte un plan aussi xénophobe que possible, puisque, dans la première séquence, l’immigration est ouvertement désignée comme la cause des troubles à l’ordre public que connaissent les Etats-Unis.
Passons rapidement sur les troisième et quatrième périodes, celle des westerns vénérés à juste titre (dès son premier essai, « Winchester 73 », en 1950, Anthony Mann signe l’un des plus grands chefs-d’œuvre du genre) et celle des péplums (« Le Cid », « La Chute de l’empire romain »), à revoir en essayant d’oublier qui en est l’auteur pour les juger avec le moins de parti pris possible.
Et venons-en à la principale qualité de « Raw Deal », qui appartient à la seconde période décrite. Il est préférable de désigner ce film pour son titre original, non par snobisme, mais parce que « Marché de brutes » est une traduction non seulement inélégante, mais aussi assez peu fidèle, « Marché de dupes » convenant mieux.
Des brutes, il y en a certes à revendre dans le film de Mann, d’une violence assez inouïe par instants. La plus fameuse scène à cet égard voit Raymond Burr ébouillanter une femme qui a juste eu le malheur de l’agacer et d’être un peu maladroite à un moment où le moindre prétexte eût été bon pour qu’il se mette en colère. S’il est un film pour lequel on peut utiliser une fois de plus l’une des plus célèbres sentences d’Hitchcock sans crainte de la galvauder, tant elle fait l’objet d’un usage intensif, et parfois abusif, c’est bien celui-là : « Plus réussi est le méchant, meilleur est le film. » Le physique de Raymond Burr a suffi pour lui assurer une carrière riche en rôles de caïds aussi féroces qu’impitoyables (notamment dans « L’Or et l’Amour » de Jacques Tourneur). S’il a trouvé ici son meilleur emploi, c’est en premier lieu grâce au travail du chef opérateur John Alton, qui alterne très habilement sur lui plans américains et plans rapprochés, plongées et surtout contre-plongées, soulignant ainsi son imposante carrure et son impressionnante stature, Raymond Burr ne bougeant que très peu et gardant presque constamment un visage fermé, dur et impassible, d’autant plus inquiétant que le moindre de ses mouvements, le moindre de ses rictus prennent de ce fait une soudaine ampleur. L’autre élément rendant le personnage qu’il interprète (Rick) si réussi est à mettre à l’actif des scénaristes. Comme d’habitude, il inspire la peur à son entourage et à ses victimes ; il faut le voir se contenter de brandir un petit briquet pour menacer de torture une femme prise en otage ou encore l’allumer derrière un comparse et l’approcher de son oreille pour s’amuser à l’effrayer. Mais l’idée particulièrement astucieuse des scénaristes est de l’avoir rendu de plus en plus agressif à mesure que sa propre peur augmente. Car lui-même, d’abord si sûr de sa force et de son stratagème (après s’être arrangé pour qu’un complice – Joe – aille en prison à sa place, il s’arrange pour le faire s’évader afin que cet « ami » compromettant soit supprimé par la police ou par ses hommes de mains avant qu’il puisse arriver jusqu’à lui pour récolter l’argent promis d’après le marché conclu, le « marché de dupes » du titre), en vient à perdre sa belle assurance et toute sérénité au fur et à mesure que Joe s’approche du lieu de rendez-vous en se jouant tant bien que mal de ses poursuivants.
(texte rédigé les 16 février et 10 mars 2004, à l'occasion de la diffusion du film sur Cinétoile ; publié au préalable sur "Cine-Studies.net").
/image%2F1488596%2F20150628%2Fob_878ee3_18203850424-0123df7778-z.jpg)
/image%2F1488596%2F20240402%2Fob_ed0b00_giovanni.jpg)
/image%2F1488596%2F20240305%2Fob_b1afc5_obregon-megatown.jpg)
/image%2F1488596%2F20240207%2Fob_cdb772_souvenirs-en-pagaille.jpg)
/image%2F1488596%2F20231115%2Fob_cc90f3_monde-d-apres-3.jpg)
/image%2F1488596%2F20231106%2Fob_9fd34f_monde-d-apres-3.jpg)
/image%2F1488596%2F20231018%2Fob_efd916_le-marginal.jpg)
/image%2F1488596%2F20230904%2Fob_88a853_dandrieu-une-cinematheque-ideale.JPG)
/image%2F1488596%2F20230811%2Fob_ac40ad_vertigo.JPG)
/image%2F1488596%2F20230726%2Fob_e5fdbb_des-images-qui-parlent.jpg)
/image%2F1488596%2F20230628%2Fob_ef29e9_jp-melville-parvulesco.jpg)